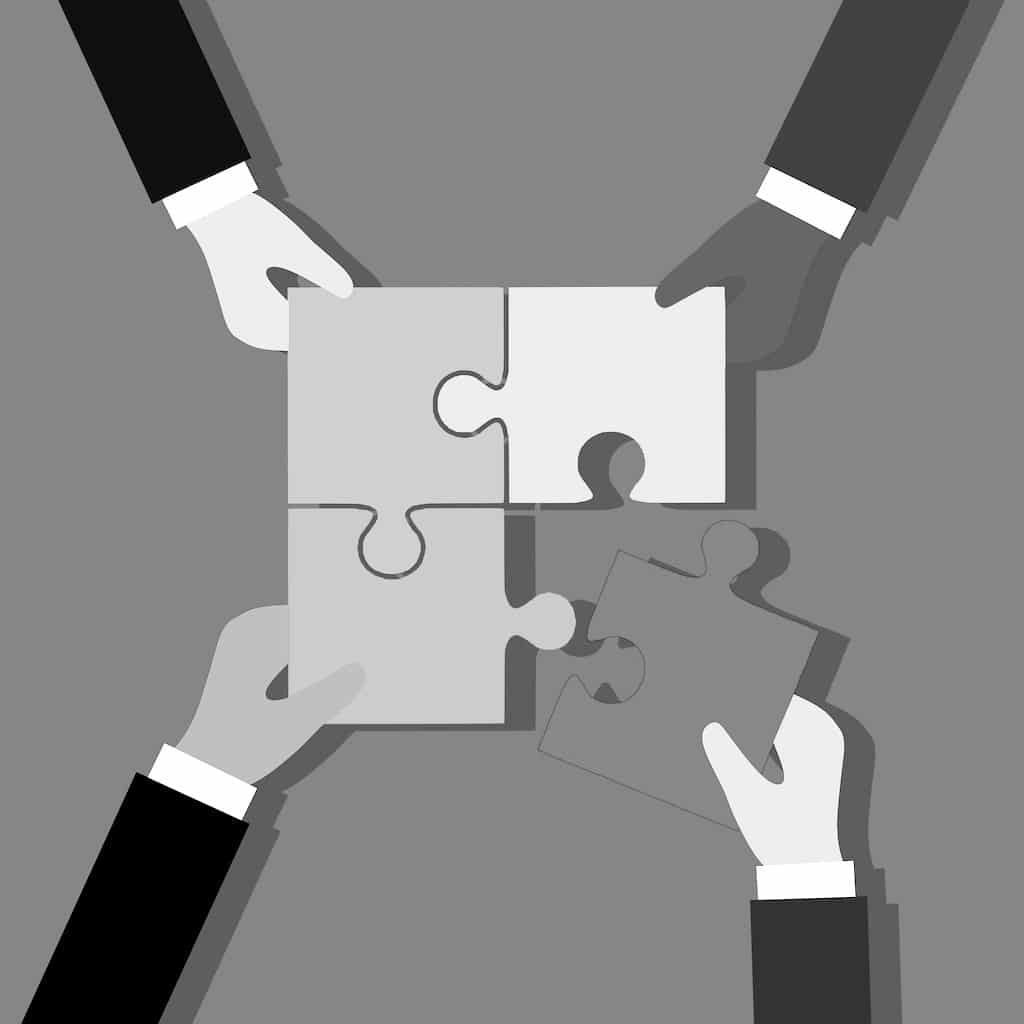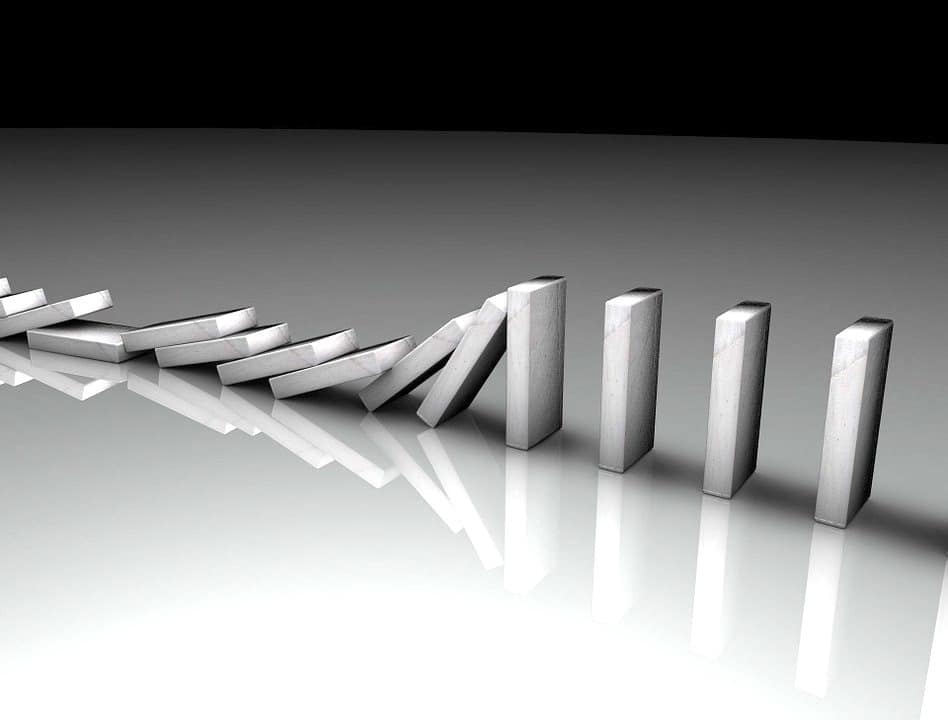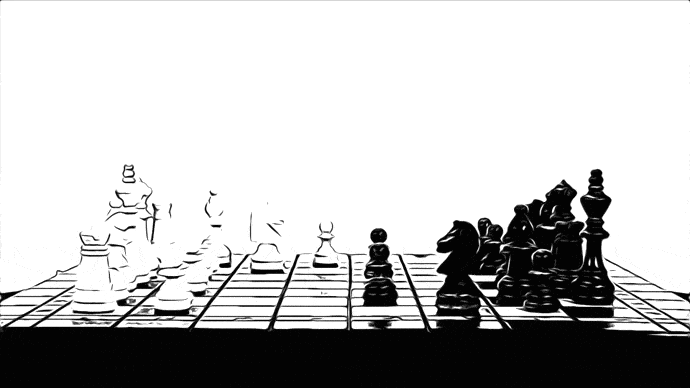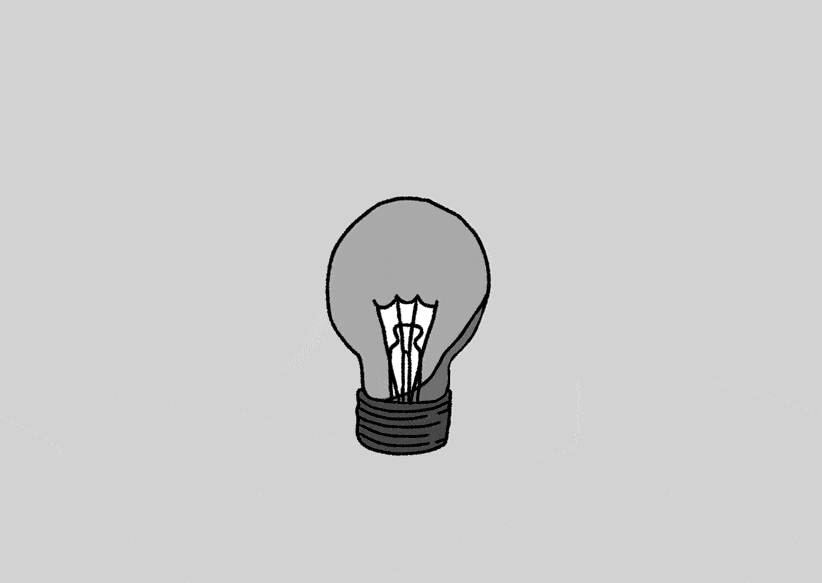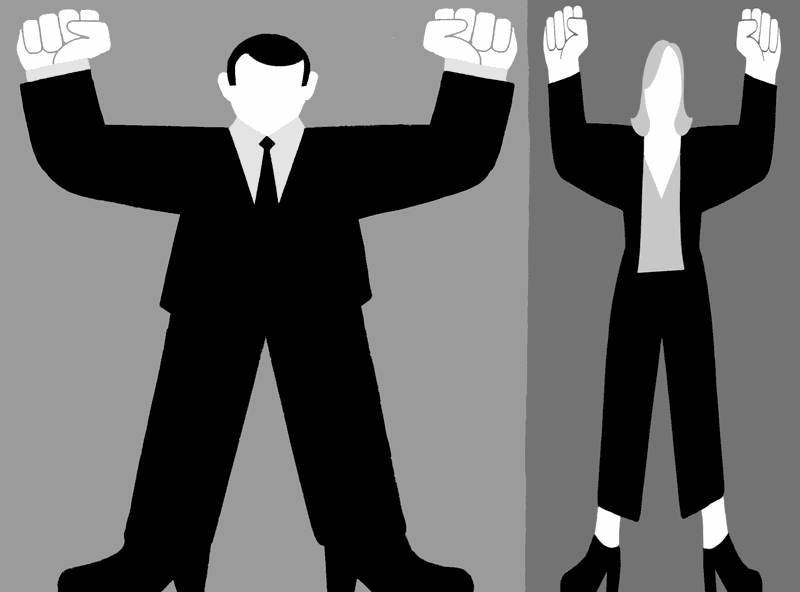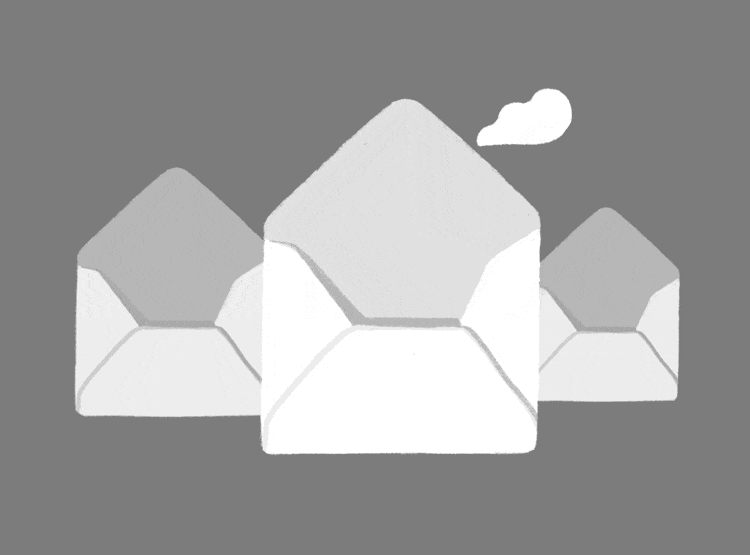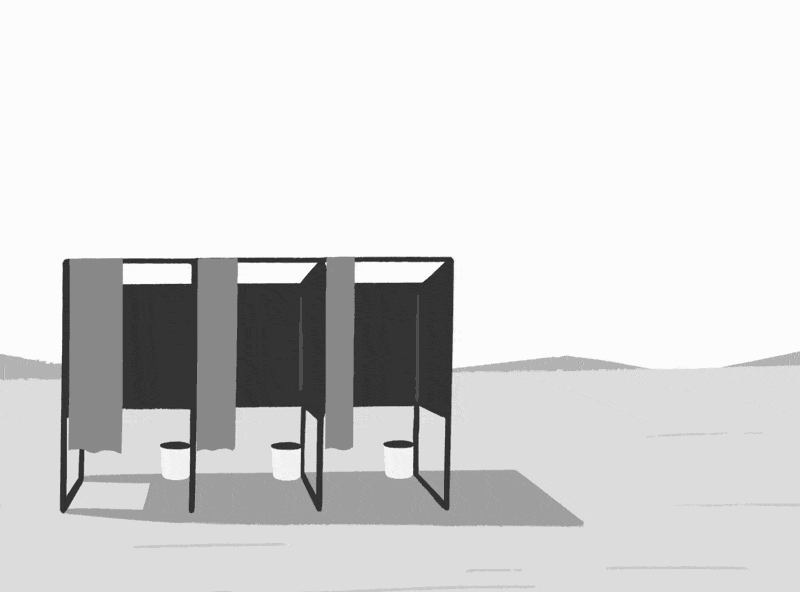PAR LOU-EVE POPPER ET NICOLAS PRISSETTE
1 – LES FAITS
Macron veut régler le problème avant la présidentielle
Comment va-t-on rembourser 215 milliards d’euros, la facture des aides publiques versées durant la crise sanitaire ? La question est très politique. Elle est de nature à inquiéter les électeurs et elle forme une ligne de clivage entre les camps dans la perspective de 2022. Emmanuel Macron veut l’avoir traitée avant la campagne présidentielle pour éviter un piège tendu par les oppositions.
Un scénario se dessine au sein de l’exécutif. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, est favorable à un cantonnement de la « dette Covid ». Les 215 milliards seraient isolés dans une caisse spécifique, comme le furent les dettes du Crédit Lyonnais ou de la Sécurité sociale dans les années 1990. Cette démarche signifie que la France entend bel et bien rembourser ses créanciers. Dans ce cadre, le commissaire au Plan François Bayrou propose néanmoins de différer les remboursements à partir de 2030 (ce qui est déjà le cas en pratique) et d’en étaler le paiement sur trente ans.
Restera tout de même à un affecter un financement. Lequel ? Bruno Le Maire promet que ce ne sera pas un nouvel impôt. Cet engagement est mis en doute par LR, où l’on estime que le gouvernement n’aura pas le choix. Une autre voie est suggérée dans l’entourage du président de la République : partager les « dettes covid » au niveau européen. Les pays de la zone euro ayant tous eu recours à l’emprunt, ils auraient intérêt à s’entendre pour apurer leur dette par un mécanisme collectif, à débattre. La France mettrait ce sujet à l’ordre du jour en prenant la présidence tournante de l’UE en janvier.
À gauche, au contraire, on plaide pour une annulation partielle des créances. Notamment celles qui sont détenues par la Banque centrale européenne. Cela ne coûterait rien, défendent les Insoumis, Thomas Piketty et d’autres économistes, car cela revient à annuler une somme qu’on se doit à soi-même. Leurs contradicteurs soulignent que le procédé est tellement négatif qu’il entraînera une défiance généralisée, aux conséquences incontrôlables. La dette met ainsi en scène un clivage droite-gauche, dans un débat politique très classique depuis le XVIIIe siècle.
Sur le plan économique, la controverse semble injustifiée. Les grandes puissances, en réalité, ne remboursent jamais vraiment leur dette. Elles inspirent suffisamment confiance aux créanciers (nationaux ou étrangers) pour emprunter sans cesse, remplaçant un vieil emprunt par une nouveau. Concrètement, seuls les intérêts sont payés, à des échéances de plus en plus longues et des niveaux actuellement très faibles – voire négatifs – grâce au soutien des banques centrales. La France est dans ce cas. Elle peut sans doute en profiter encore, à moins d’un scénario catastrophe qui verrait son économie s’effondrer et ses compétences disparaître.

2 – LES DONNÉES
D’où vient l’argent et combien doit-on ?
Le niveau de la dette
Au 31 janvier, la dette de l’État s’élevait très exactement à 2.032.414.237.173 euros. Plus de 2.000 milliards, donc. En économie, on rapporte souvent ce montant au Produit intérieur brut (PIB, la richesse produite en un an) pour en signifier le poids. En l’occurrence, la dette totale de la France représente plus de 115% de son PIB, un niveau jamais atteint par le passé. Ce ratio permet d’établir des comparaisons internationales mais il ne donne pas d’indication sur les capacités de remboursement.
D’autres ratios permettent de mieux appréhender le poids d’une dette. D’une part, le rapport entre les emprunts annuels et les richesses annuelles. Durant la dernière décennie, la France a emprunté chaque année l’équivalent de 8% de ses richesses produites. Avec la crise de 2020, ce rapport est monté à près de 12%. D’autre part, le calendrier de remboursement est décisif. La durée moyenne des emprunts est actuellement de 8 ans et 120 jours. Elle a tendance à se raccourcir un peu.
Son coût
La charge de la dette (le paiement des intérêts) coûtait 45 milliards d’euros par an à l’État au début de la décennie 2010. Elle s’est ensuite allégée, à la faveur des baisses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. C’est un élément décisif : la charge est ainsi passée sous la barre des 40 milliards d’euros annuels en dépit de la crise, à la faveur de l’évolution des taux, faibles puis négatifs.
Qui sont les créanciers
La dette française est détenue pour moitié (51,3%) par des institutions étrangères : banques centrales, fonds souverains, grandes banques, etc. Leur part est aujourd’hui au plus bas depuis 2004 et elle devrait passer sous la barre des 50% prochainement. Elle n’a cessé de diminuer depuis le milieu des années 2010, parce que la dette est rachetée progressivement par la Banque centrale européenne. La BCE détient en ce début d’année entre 25% et 30% de la dette française, selon des indications officieuses (le chiffre exact n’est pas encore connu). Le reste est aux mains de structures françaises (assurances, banques…). C’est-à-dire, concrètement, qu’elle capte les économies des épargnants, actionnaires et sociétaires français de ces établissements.
D’où vient l’argent
Les grandes banques, assurances et fonds privés et publics cherchent en permanence à placer l’épargne de leurs clients, qui est surabondante à l’échelle du globe. La dette française leur offre un cadre qu’ils estiment sûr. Résultat, ils sont trop nombreux à vouloir acheter des titres d’emprunt tricolores et ils acceptent même que ce placement ne leur rapporte rien, voire leur coûte une part de la mise ! Depuis le début de l’année, les taux français sont en moyenne de ‑0,13%. Autrement dit, pour 1.000 euros prêtés, les créanciers acceptent qu’on ne leur rende que 998,7 euros. Ce choix peut paraître irrationnel mais il signifie que les autres placements potentiels (dans des entreprises, par exemple) paraissent encore plus risqués aux yeux des investisseurs.
Par exemple, Bercy a fait un tour de table le 18 février pour obtenir 10 milliards d’euros. Les créanciers, eux, étaient prêts ce jour-là à transférer 23 milliards dans les caisses de l’État : tous n’ont donc pas pu réaliser l’opération qu’ils voulaient. Alors même que le taux d’intérêt proposé par la France était de 0% pour les remboursements à échéance 2026 et 0,5% pour 2029.
Que proposent les partis d’opposition ?

Les Républicains sont divisés
Le parti a émis des propositions diverses pour gérer la dette. Sur une ligne « sociale », le numéro 2 du parti, Guillaume Peltier, estime que la dette Covid est « une dette de guerre » qui doit être traitée à part, en étant transformée en dette perpétuelle ou bien en allongeant le calendrier de remboursement « à échéance de cent ans ». Elle pourrait aussi être remboursée par la création d’une taxe carbone aux frontières de l’UE – projet qui est actuellement à l’étude pour payer le plan de relance européen. En gage de saine gestion vis-à-vis des marchés, le député du Loir-et-Cher propose que la France s’impose des comptes à l’équilibre en 2030 (« une règle d’or budgétaire ») et un plan de lutte contre les fraudes fiscale et sociale (« une règle d’or anti-gaspillage ») ainsi qu’une restriction des aides sociales aux étrangers.
Une ligne « rigoriste » est, elle, incarnée par Eric Woerth, qui insiste sur les efforts nécessaires de maitrise des dépenses publiques. Pas question pour l’ancien ministre du Budget de cantonner la dette Covid dans une caisse spécifique. Ce serait « un artifice inutile et dangereux », explique-t-il. Selon lui, une telle option rendrait inéluctable la création d’un impôt pour remettre cette caisse à flots.
Le PS veut taxer les Gafa et les riches
Le premier secrétaire du PS Olivier Faure entend mettre à contribution « les profiteurs de la crise ». Il cite dans cette catégorie les Gafam, les laboratoires pharmaceutiques et la grande distribution « qui se sont enrichis fortement » durant la période récente. L’an dernier au printemps, le groupe PS à l’Assemblée nationale avait proposé dans une tribune au JDD de lever un impôt sur « les 1% de contribuables qui concentrent aujourd’hui près de 20% de la richesse nationale ». S’y ajouteraient une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu, une réforme des prélèvements sur les gains de l’épargne, une restauration de l’ISF, une hausse des droits de succession, des mesures contre l’optimisation fiscale des entreprises au niveau européen… Tout en précisant : « Les 99% citoyens qui ne participeront pas à cet « effort de paix » ne doivent pas être exonérés d’une réflexion au long cours sur une réforme en profondeur de notre fiscalité, notre style de vie ou encore notre modèle de développement… »
LFI, favorable à l’annulation
La France insoumise est le principal défenseur d’une annulation de la dette. « Personne ne paiera jamais la dette publique », assure-t-il. Jean-Luc Mélenchon s’en est longuement expliqué sur son blog dès avril 2020. Le leader des Insoumis a un plan en deux temps. D’abord, ce qu’il appelle « la petite annulation ». Il s’agirait de convertir les emprunts français détenus par la Banque centrale européenne en rente perpétuelle à taux nul (un oxymore). Autrement dit, cette dette n’aurait plus de sens. Mélenchon veut ensuite appliquer la même recette aux autres détenteurs des emprunts français. Il considère que « une fois soulagé de la dette, on peut planifier la redéfinition de la façon de produire et d’échanger, de l’énergie, des infrastructures publiques et ainsi de suite. Et on peut réemprunter ». Il ne dit pas quel créancier il envisagerait de solliciter après une telle opération. Par ailleurs, le candidat à la présidentielle propose que l’État prenne l’argent des Livrets A et qu’il supprime les avantages fiscaux de l’assurance-vie pour les épargnants qui détiennent des titres d’entreprises étrangères.
Marine Le Pen, pour le remboursement
La patronne du RN, candidate à la présidentielle, a changé son discours. Elle ne conteste plus les règles financières de la zone euro, qu’elle jugeait inadmissibles au nom de l’indépendance de la France. Son propos est devenu orthodoxe. « Une dette doit être remboursée. Il y a là un aspect moral essentiel. À partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieure, sa parole est d’airain », a‑t-elle écrit dans une tribune au journal l’Opinion. Et d’insister : « La signature France sera préservée et confortée ». Ce changement de doctrine peut s’expliquer par tactique électorale. Il correspond à la volonté de rassurer l’électorat des seniors, qui vote relativement moins pour son parti que d’autres tranches d’âge. Toujours nationaliste, le RN veut que la dette soit davantage détenue par des investisseurs français.
Une forte hausse de l’endettement chez nos voisins

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Selon les données d’Eurostat, de nombreux États membres de l’UE se sont massivement endettés pour permettre à leurs économies de tenir face à la crise. À l’échelle de la zone euro, le ratio de la dette publique par rapport au Produit intérieur brut (PIB) s’établissait à 97,3 % fin septembre, contre 85,8 % un an plus tôt.
Entre mars et juin 2020, soit au moment du déferlement du Covid-19 en Europe et des premiers confinements, les pays qui ont vu leur niveau de dette publique augmenter le plus sont Chypre (+ 17,1 points de pourcentage), la France (+ 12,8), l’Italie (+ 11,8), l’Espagne (+ 11,1), la Croatie et la Belgique (+11 chacune), la Slovaquie (+10,6) et la Grèce (+10,5). Des pays dont les économies, pour la plupart, dépendent beaucoup du tourisme. Même l’Allemagne, pourtant connue pour son aversion à la dépense, a été contrainte de desserrer les cordons de la bourse. D’après Eurostat, au troisième semestre 2020, la dette publique allemande s’élevait à près de 70 % de son PIB, bien loin donc de la règle budgétaire européenne des 60 % qu’elle respectait, à peu de choses près, un an plus tôt. D’autres pays de l’UE ont été relativement épargnés par la crise du printemps, comme l’Estonie, la Bulgarie ou encore le Luxembourg.
Parmi ceux qui ont le plus souffert, l’Espagne obtient une triste première place. Dans ses Prévisions de l’économie mondiale publiées en octobre 2020, le FMI anticipait une augmentation du taux de chômage (16,8 %) et un recul du PIB espagnol de 12,8 %, faisant de ce pays l’économie avancée la plus touchée par la crise sanitaire en Europe. L’endettement à grande échelle ne résout pas tout. Certes, notre voisin peut toujours se financer sur les marchés de capitaux internationaux : « En 2020, l’Espagne a emprunté pour dix ans à des taux négatifs, elle peut continuer à s’endetter sans problème », explique l’économiste Eric Berr.
Mais le prix économique et social est d’autant plus élevé que cette économie est essentiellement tournée vers les services et le tourisme. En 2019, ce secteur représentait 10,3 % du PIB, selon le World Travel and Tourism Council. Résultat : alors que mi-février l’Espagne faisait face à des taux de contamination élevés, le gouvernement de Pedro Sànchez avait préféré opter pour des confinements localisés, avec des niveaux de restrictions dépendant des régions.
Le Pacte de stabilité européen remis en chantier
Déjà près de trente ans : en 1992 était signé le Traité de Maastricht, lequel imposait aux États membres le respect de règles budgétaires communes. Ces dispositions, reprises dans le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), étaient les suivantes : le déficit public et la dette publique des pays ne devaient pas dépasser 3 % et 60 % du produit intérieur brut (PIB).
En mars 2020, les critères ont volé en éclats avec la crise économique et sociale provoquée par le coronavirus. Les États ont suspendu les règles pour emprunter massivement, afin de financer les plans de chômage partiel et les aides aux entreprises et aux ménages. Pour la première fois, les Vingt-Sept se sont également mis d’accord pour lever de la dette sur les marchés financiers au nom de l’UE, permettant ainsi de débloquer un plan de relance de 750 milliards d’euros.
L’UE a décidé début mars que le Pacte de stabilité serait suspendu jusque fin 2022. En outre, une consultation s’ouvre pour sa réécriture. « Notre message est que le soutien budgétaire doit se poursuivre aussi longtemps que nécessaire », explique le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.
En France, le secrétaire d’État aux Affaires Européennes Clément Beaune a expliqué dans un entretien à l’AFP : « On ne pourra pas remettre en place le Pacte de stabilité tel qu’on l’a connu auparavant parce que la crise est passée par là, parce que nous sommes dans une période où il faudra, encore plus qu’avant la crise, investir pour nos économies ». Un discours repris par le Portugal, qui assure jusqu’en juin 2021 la présidence du Conseil de l’Union européenne. Le ministre des Finances Joao Leao a ainsi estimé qu’ayant « vécu deux fois en dix ans des crises qui ne surviennent normalement qu’une fois par siècle, nous devons repenser nos règles budgétaires ».
Le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni avait reconnu en février que « la stabilité demeure un objectif essentiel, mais la nécessité de soutenir la croissance et, en particulier, de mobiliser l’énorme volume d’investissement que réclame la lutte contre le changement climatique est tout aussi pressante ».
Publié le 20 octobre 2020, le rapport annuel du comité budgétaire européen (EFB), un organe de consultation indépendant de la Commission européenne, contribue au débat. Celui-ci préconise que le seuil de 60% soit relevé. L’organe consultatif estime par ailleurs que le plan de relance validé par les États membres, qui est pour le moment temporaire, pourrait être un premier pas vers un fond budgétaire européen permanent.
Argentine, Grèce, États-Unis… Quand la dette déclenche des crises, ou pas
Par le passé, certains pays se sont retrouvés en défaut de paiement. D’autres ont réussi à résorber leur dette par eux-mêmes.
En 2001, la situation de l’Argentine est catastrophique. Le président Néstor Kirchner parvient cependant, en 2005, à obtenir de la plupart de ses créanciers un effacement de 70 % de leurs titres. Une victoire qui permet ensuite au pays de remonter la pente. Grâce notamment à des exportations fructueuses, l’Argentine parvient à faire rentrer des devises étrangères et notamment le dollar, la monnaie dans laquelle elle s’est endettée. Avec la crise financière de 2008, le pays replonge toutefois dans les difficultés. Sous le mandat du conservateur Mauricio Macri (2015–2019), l’État argentin est à nouveau contraint de réclamer l’aide financière du FMI.
En 2010, la Grèce se déclare incapable de subvenir à ses besoins. Des prêts sont alors accordés au pays par les institutions internationales contre des réformes structurelles, jugées par leurs opposants comme des réformes d’austérité. En 2015, les élections portent au pouvoir le parti d’Alexis Tspiras qui réclame à ses principaux créanciers – la Troïka, formée alors de la BCE, du FMI et de la Commission européenne – d’alléger les règles budgétaires. Mais rien n’y fait. Après cinq mois de négociations, l’économie grecque est mise sous tutelle : toute décision budgétaire et fiscale est soumise à l’accord préalable de la Troïka avant d’être présentée au Parlement. Cette surveillance s’est achevée en 2018.
Aux États-Unis, l’endettement atteint des sommets lors des deux conflits mondiaux. Pour autant, la Seconde Guerre mondiale est financée par des emprunts à taux d’intérêt très faibles. Et dans l’immédiat après-guerre, les États-Unis bénéficient encore de taux d’intérêt réels négatifs (c’est-à-dire des taux d’intérêt qui prennent en compte l’inflation). Associés à une forte croissance de l’économie, ils ont permis de réduire rapidement le niveau d’endettement.
Le Japon est un cas particulier. Sa dette s’élevait, en 2019, à 240 % du PIB. Pour autant, le pays continue d’emprunter sans que soit questionnée sa solvabilité. La raison ? Ses créanciers sont des nationaux. La dette est en effet très largement détenue par la banque centrale japonaise ainsi que par des institutions financières et des compagnies d’assurance nippones. Résultat : le pays ne craint pas de se retrouver sous l’emprise d’investisseurs étrangers qui pourraient, en cas de panique, placer leur argent dans d’autres pays. « Par ailleurs, l’État japonais peut théoriquement jouer sur la fiscalité, par exemple en augmentant les impôts de ses créanciers nationaux afin de renforcer la soutenabilité de la dette publique », explique l’économiste Eric Berr .
3 – L’ÉCLAIRAGE DE L’ÉCONOMIE
Annuler la dette ?
Par Jean-Marc Daniel, professeur à l’ESCP
L’augmentation de la dette publique en France est spectaculaire. Elle tangente 120% du PIB et devrait atteindre 2.675 milliards d’euros à la fin de l’année. Un débat est né sur les moyens de répondre aux angoisses que cette augmentation suscite. Faut-il annuler cette dette, le peut-on ? L’histoire et l’économie nous fournissent des réponses.
Pour certains, il conviendrait d’émettre un emprunt perpétuel comme on le faisait naguère, la dernière émission datant de 1949 en France. Ce processus consiste pour l’État à verser des intérêts ad vitam au créancier, sans jamais lui rembourser le montant initialement prêté (appelé le principal).
Or la dette publique est déjà perpétuelle, en pratique. En effet, quelle que soit la durée des emprunts, les États se contentent en réalité de verser des intérêts aux créanciers. Depuis le début du XIXe siècle, aucun crédit n’est inscrit dans leur budget pour le remboursement du principal, ce que l’on appelle son amortissement. Chaque fois qu’un emprunt arrive à échéance, il est immédiatement remplacé par un nouvel emprunt.
L’enjeu de la dette pour un État n’est donc pas son remboursement stricto sensu mais sa charge, c’est-à-dire le montant des intérêts à verser chaque année. Pour la réduire, deux pistes s’ouvrent : maintenir des taux d’intérêt bas ou bien annuler tout ou partie de l’emprunt.
La première option est d’ores et déjà à l’œuvre dans les pays développés depuis la crise financière de 2009. Elle est favorisée par la politique monétaire des banques centrales, que l’on appelle quantitative easing. L’idée que la banque centrale doive soulager les États d’une charge devenue très lourde n’est pas nouvelle. Aux États-Unis, elle a été entérinée dans les statuts de 1978 de la Réserve fédérale américaine (1).
Faut-il envisager d’aller au-delà et en venir à la seconde option ? Doit-on « faire banqueroute » pour reprendre le vocabulaire d’autrefois ? Le coût prendrait deux formes : une forme économique et une forme politique. Sur le plan économique, on assisterait à une augmentation immédiate des taux d’intérêt des nouveaux emprunts – signe d’une défiance accrue des créanciers provoquée par la décision de les priver de leurs avoirs – voire à une impossibilité d’émettre de nouvelles dettes. En 2011, la Grèce a annulé, après négociations avec ses créanciers, 30% de sa dette publique. Elle n’a plus pu emprunter sur les marchés pendant huit ans.
Pour qu’une annulation ne pénalise pas l’État, il faudrait qu’il n’ait tout simplement plus besoin d’emprunter ; c’est-à-dire que ses comptes (hors charge de la dette) soient équilibrés. Cet équilibre dit primaire est la condition sine qua non pour une banqueroute économiquement réussie, sans conséquences financières.
Or, en 2019, avant même la crise sanitaire, le déficit primaire français était proche de 60 milliards d’euros (alors que l’Italie, souvent montrée du doigt, dégageait un excédent primaire). Autrement dit, la condition économique est loin d’être remplie, sauf à imaginer une amputation des dépenses ou une flambée des impôts.
Sur le plan politique et social, une annulation se heurterait à la réaction plus ou moins violente des épargnants spoliés. Le gouvernement pourrait certes les accuser d’être des rentiers, c’est-à-dire de « s’enrichir en dormant » et invoquer, selon une expression d’un obscur économiste germano-argentin du nom de Silvio Gesell, reprise et popularisée par Keynes, la nécessaire « euthanasie des rentiers ».
Mais l’histoire a montré que cette « euthanasie » n’était pas sans conséquences. Le « rentier euthanasié » – c’est-à-dire l’épargnant ruiné – par la banqueroute ou l’inflation, est sensible aux discours en faveur de l’ordre. La dernière banqueroute organisée en bonne et due forme en France qui remonte à 1797 servit de justification au coup d’État de Bonaparte en 1799. Ce dernier fonda dans la foulée la Banque de France en 1801 et mis un terme à la carrière politique de Dominique Ramel, le ministre des finances de 1797. Quant à la ruine de l’épargnant allemand dans les années 1920, elle l’a conduit à joindre ses voix aux chômeurs de la crise de 1929 pour porter les nazis au pouvoir.
La banqueroute reste, pour reprendre un discours de septembre 1789 de Mirabeau, « hideuse ». Le premier Grand Homme à entrer au Panthéon s’écriait face aux partisans d’une annulation : « Croyez-vous, parce que vous n’avez pas payé, que vous ne devrez plus rien ? Croyez-vous que les milliers, les millions d’hommes qui perdront en un instant, par l’explosion terrible ou par ses contrecoups, tout ce qui faisait la consolation de leur vie, et peut-être leur unique moyen de la sustenter, vous laisseront paisiblement jouir de votre crime ? »
Ce refus d’une faillite d’État a pris une forme de solennité dans la Constitution de la IIe République, qui stipule dans son article 14 : « La dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses créanciers est inviolable ». De nos jours, où tout responsable public se sent en devoir de se déclarer avec emphase « républicain », on devrait se souvenir des principes des ancêtres de 1848 !
Conscients de ces limites, les défenseurs actuels d’une annulation de la dette limitent leur projet à la part détenue par « le système européen de banques centrales », c’est-à-dire par la Banque centrale européenne et les banques centrales de la zone euro. Pour la justifier, ils affirment que la baisse induite du ratio apparent d’endettement rassurerait les marchés et les opinions, permettant d’emprunter à nouveau pour financer des plans de relance qu’ils appellent de leurs vœux.
Ce raisonnement appelle une observation qui l’invalide. En réalité, le bénéfice économique d’une telle décision serait nul. Car le fait qu’une banque centrale détienne de la dette publique de son pays équivaut déjà pour celui-ci à une annulation de ses charges. En effet, selon le fonctionnement usuel d’une banque centrale, les intérêts perçus par elle sont rendus à son actionnaire qui n’est autre que l’État endetté qui vient de les lui verser ! (2)
Au bout du compte, l’annulation pose des questions qui ne sont pas économiques : au nom de quoi fragiliser le système européen de banques centrales en déséquilibrant son bilan (avec la disparition d’une partie de ses actifs) ? Pourquoi engager un bras de fer avec nos partenaires européens sur le statut de la dette détenue par chaque banque centrale puisque, d’ores et déjà, ses conséquences financières sont annulées ? Par ailleurs, la population serait-t-elle rassurée par une baisse de l’endettement affiché ou bien serait-elle inquiète de voir la parole publique trahie ?
(1) Ceux-ci précisent en effet qu’elle a trois missions : « Maintenir en moyenne une croissance des agrégats monétaires et de la quantité de crédit compatible avec le potentiel de croissance de la production, de manière à tendre vers les objectifs suivants : un taux d’emploi maximum ; des prix stables ; des taux d’intérêt à long terme peu élevés. »
(2) les intérêts sont en effet versés à la banque nationale et non pas à la BCE. La BCE et les banques nationales constituent ensemble le « système européen de banques centrales ».
MAKING-OF
Nous sommes partis de questions simples : d’où vient l’argent, que doit-on rembourser exactement ? Nous avons regardé les chiffres, établi les comparaisons, recherché les arguments partisans, etc. Un grand écart nous est alors apparu entre le débat politique, fondé à droite comme à gauche sur la peur provoquée par la montagne de dette, et ce que dit l’économie, bien plus rassurant.